Christopher Dembik, Senior Investment Advisor chez Pictet Asset Management depuis septembre dernier, et précédemment responsable de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank, partage ses convictions. Comme à son habitude, il adopte des positions claires sur différents sujets économiques et financiers et illustre la stratégie d’investissement du gestionnaire d’actifs par des graphiques. En ce qui concerne le stockpicking, il estime que le moment est propice, mais qu’il vaut mieux éviter les petites capitalisations.
Comment les clients envisagent-ils l’investissement maintenant que les taux d’intérêt sont plus élevés qu’il y a quelques années ? Ont-ils déjà adapté leurs attentes et leur portefeuille ?
Christopher Dembik : Il est vrai qu’il a été difficile de s’adapter à une hausse des taux d’intérêt beaucoup plus importante qu’attendu et que le marché n’avait objectivement pas anticipé au début de l’année. Aujourd’hui, tout le monde est convaincu que les obligations sont essentielles en tant que véhicule d’investissement. Mais le débat sur les maturités à privilégier est toujours d’actualité. Chez Pictet, nous sommes très clairs : pour l’instant, nous nous en tenons aux maturités courtes. En début d’année, en janvier ou février, nous verrons s’il est judicieux de passer aux échéances longues. Cette position est motivée par les risques géopolitiques et politiques actuels et par la grande incertitude concernant la politique monétaire. Le marché anticipe déjà des baisses de taux d’intérêt car il y a un consensus sur une baisse imminente de l’inflation. Mais ces baisses auront-elles bien lieu ? Certains économistes prévoient, eux, une hausse de l’inflation pour l’année prochaine. Ce n’est pas ce que nous attendons, mais cela montre qu’il n’est pas évident d’investir aujourd’hui dans des échéances longues.
Aujourd’hui, le marché anticipe déjà plusieurs baisses de taux d’intérêt. Pensez-vous que ce soit trop tôt ?
Christopher Dembik : Oui, car pour nous, le timing n’est pas le bon. Il est fascinant de constater que le marché applique exactement le même calendrier que lors des cycles économiques précédents. La règle générale veut qu’entre la fin du cycle de hausse des taux et la première baisse des taux, il s’écoule 6 à 9 mois. Plusieurs éléments sont pourtant complètement différents des cycles précédents. Premièrement, l’inflation restera élevée plus longtemps en raison, entre autres, de la transition énergétique, de la relocalisation des productions, etc. Le taux d’inflation dépassera indéniablement l’objectif de 2 % dans les années à venir. Et deuxièmement, une récession sévère n’est pas imminente et une croissance de 1 à 1,5 % est attendue : pas vraiment spectaculaire mais positive. La baisse des taux d’intérêt n’apportera pas de croissance supplémentaire. Pour ma part, je pense que le seul argument qui pourrait être utilisé aux États-Unis et en Europe pour réduire les taux d’intérêt est une détérioration significative du marché du travail. Or, à l’instar de la Réserve fédérale et de la BCE, nous ne nous attendons pas à cela. Il est tout à fait possible, et c’est mon scénario, d’avoir un ralentissement économique avec un taux de chômage relativement bas, car il ne faut pas oublier que les entreprises ont encore beaucoup de mal à trouver du personnel.
Quel est votre point de vue sur les marchés ?
Christopher Dembik : L’avenir suscite de grandes inquiétudes. Et ces inquiétudes ne concernent pas tant une récession imminente, car celle-ci peut être gérée. La crainte est que nous nous dirigions vers un contexte de désordre géopolitique tout en ayant une croissance faible. Dans un tel environnement, il est beaucoup plus difficile de générer des rendements. C’est pourquoi nous avons une vision très prudente et défensive à court terme, avec une préférence pour les obligations de 1 à 3 ans, et sur le marché des actions, nous privilégions les titres de qualité. Ces valeurs peuvent sembler un peu chères aujourd’hui, mais elles sont capables de résister à une éventuelle récession ou du moins à des problèmes de refinancement. Nous recherchons en fait un airbag dans notre portefeuille d’investissement. Nous sommes tous conscients du débat autour du fait que beaucoup d’argent est investi dans seulement 7 actions américaines et quelques valeurs de luxe européennes. C’est très déséquilibré alors que ces valeurs semblent chères à ces niveaux. Nous savons également que si vous regardez le S&P 500, vous avez en fait 493 actions qui sont sous-évaluées, mais qui ne parviennent néanmoins pas à attirer l’argent des investisseurs. Tel est l’état du marché aujourd’hui et, malgré tout, vous devriez avoir des actions technologiques chères dans votre portefeuille. Il ne sert à rien de changer de cap si l’ensemble du marché évolue dans la même direction.
La période est-elle propice à la sélection de titres ?
Christopher Dembik : De nombreuses grandes entreprises sont sous-évaluées. Mais ce qui est important, si vous faites du stockpicking, c’est aussi de regarder où vont les flux de trésorerie. Or aujourd’hui, ces flux ne vont pas vers ces entreprises. D’une part, l’accès à l’analyse financière est plus difficile pour de nombreuses valeurs car de moins en moins d’analystes les suivent. D’autre part, des problèmes de refinancement risquent d’apparaitre en 2024 et de devenir aigus en 2025. De plus, certaines entreprises prometteuses utilisent des méthodes de financement dilutives, telles que les obligations convertibles. Rien de tout cela n’est idéal pour un investisseur, c’est pourquoi nous sommes très prudents lorsque nous sélectionnons des actions.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ces flux de trésorerie ? Que se passerait-il si ces flux s’inversaient ?
Christopher Dembik : Nous regardons les flux de trésorerie d’un point de vue géographique top-down. Aujourd’hui, il n’est pas surprenant que ces flux se dirigent principalement vers les États-Unis. Toutefois, nous constatons également que le Japon attire à nouveau l’argent : nous sommes au plus haut depuis 10 ans sur ce plan, ce qui rend le marché boursier japonais intéressant. En revanche, dans les autres zones, les flux s’assèchent pour résumer la situation. Il existe également une dichotomie au sein de certains marchés : en France, par exemple, une poignée d’actions attirent d’énormes quantités d’argent. Ce mouvement dure depuis deux ans et pourrait se poursuivre encore longtemps. C’est pourquoi nous essayons d’élaborer une stratégie qui nous permette d’intervenir en cas de rééquilibrage. Cependant, nous sommes convaincus que cette dichotomie va se poursuivre et qu’il y a des raisons fondamentales à cela, comme l’avènement des ETF qui ont tendance à valoriser les grandes entreprises. Cela signifie que les petites et moyennes capitalisations, y compris les mieux gérées, continueront à avoir beaucoup de mal à attirer l’attention des investisseurs. Si l’on regarde les petites capitalisations françaises, on constate que leur performance est inférieure à celle des grandes capitalisations depuis 5 ans. Bien sûr, les gestionnaires de fonds de petites capitalisations vous diront que c’est le moment idéal.
Pourquoi les États-Unis restent-ils si intéressants pour investir ?
Christopher Dembik : Nous nous attendons tout simplement à y réaliser des rendements plus élevés qu’en Europe. Je vais étayer mon propos par un exemple. Aujourd’hui, vous avez une obligation américaine à haut rendement d’une maturité de 1 à 3 ans avec un rendement moyen d’un peu moins de 9 %. Alors que sur le marché monétaire, le rendement oscille autour de 4-5 %, sans tenir compte du risque de change. Au vu de ces niveaux attrayants, vous devriez donc avoir une certaine exposition aux obligations américaines dans la partie obligataire de votre portefeuille. Bien entendu, les obligations d’État européennes peuvent également être intéressantes. Cependant, nous avons une préférence pour les États-Unis parce que, j’ose le dire, c’est là que la chute de la productivité sera la plus faible. L’innovation y est très présente, les capitaux continuent d’affluer dans le pays et les performances économiques resteront sans aucun doute fortes, ou du moins relativement meilleures qu’ailleurs. Pour nous, les États-Unis représentent donc un choix très important.
Même question pour le Japon. Pourquoi ce choix ?
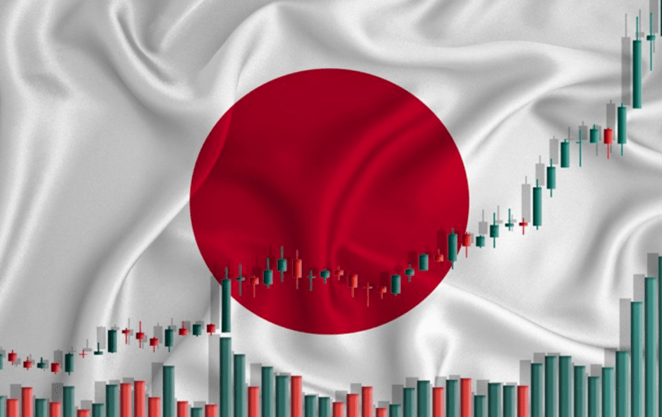
Christopher Dembik : Le Japon est, pour nous, très intéressant parce qu’il représente une diversification géographique significative pour nos clients. Deux arguments fondamentaux justifient le choix du Japon. Il s’agit d’une région développée qui sort de la déflation et qui figure parmi les pays développés les plus attractifs avec une prévision de croissance de 1,2 % pour l’année prochaine. En outre, c’est un bon moyen de jouer la Chine. Le pays fait l’objet de beaucoup de doutes, mais si la reprise chinoise se concrétise, le Japon sera le premier pays à en bénéficier puisqu’il est le premier partenaire commercial de la Chine : il représente 20 % du commerce japonais. De plus, les touristes chinois reviennent enfin au Japon, maintenant que les voyages organisés sont de nouveau autorisés, et ces touristes chinois représentent un tiers de l’ensemble des dépenses des touristes internationaux au Japon. C’est donc une véritable mine d’or.
Dans quelles autres actions investissez-vous ?
Christopher Dembik : En bref, dans des actions de qualité à court terme et des actions de croissance à long terme. Mais en fait, les valeurs de croissance et les valeurs de qualité, comme dans le secteur du luxe par exemple, sont plus ou moins la même chose. Nous investissons aussi de manière thématique, parce que c’est dans l’ADN de Pictet et que les thèmes modifient l’économie de manière structurelle. L’économie numérique est un thème intéressant ; la transition énergétique aussi même si nous devons être un peu plus sélectifs à ce sujet. Nous restons convaincus que d’ici 2030, ces objectifs durables doivent être atteints. En France, par exemple, les collectivités locales, qui jouent un rôle majeur dans la transition énergétique, devront doubler leurs budgets d’investissement chaque année. Nous investissons également dans les pays émergents, et notre préférence va clairement à l’Inde et à l’Amérique latine.
Quelles opportunités de diversifier davantage son portefeuille voyez-vous ? Les matières premières ?
Christopher Dembik : Nous préférons rester à l’écart des matières premières, tout simplement parce qu’elles sont difficiles à prévoir et trop volatiles. Par exemple, le marché s’attendait à une très forte hausse des prix du blé en raison des conditions géopolitiques. Mais ils sont au plus bas depuis deux ans.
Vous avez évoqué les difficultés de financement des petites entreprises. Que peut-on en dire ?
Christopher Dembik : Je peux vous vous parler du cas spécifique d’une entreprise industrielle française de taille moyenne. Avant le Covid, elle pouvait se financer à du 2 ou 3%. Aujourd’hui, elle doit refinancer une obligation et le fait à du 12%. Attention, il s’agit d’une bonne entreprise qui dispose d’importantes liquidités et d’un beau bilan. Mais qu’en est-il des entreprises en difficulté qui n’ont pas beaucoup de liquidités ? Il y aura certainement de nombreuses mésaventures dans les mois et les années à venir. Ce n’est pas pour rien que le nombre de défaillances d’entreprises en France est aujourd’hui à son plus haut niveau depuis 2019. La seule incertitude concerne le rythme : rapide ou lent. Et la vitesse dépendra de l’impact macroéconomique. Nous pensons qu’il sera plutôt lent. Par ailleurs, il y a les grandes entreprises qui ont de l’argent et qui ont bien géré leur trésorerie, pour elles ce sera beaucoup plus facile.
Les États auront-ils aussi des problèmes financiers ?
Christopher Dembik : Pour nous, ce risque concerne plutôt les entreprises, pas les États. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas un problème d’endettement élevé, mais il ne se transformera pas immédiatement en crise. Le pays qui connaît le plus grand dérapage budgétaire et celui que les marchés observent le plus est le Royaume-Uni. Les taux d’intérêt y sont encore plus élevés qu’en Grèce mais nous ne tablons pas sur un scénario de récession ou de morosité pour 2024. Pour nous, le vrai problème est qu’il n’y a pas de moteur de reprise et que la croissance sera donc très faible. En outre, l’environnement international reste turbulent et nous nous attendons à ce que cela reste la norme. Nous sommes positifs sur les obligations d’État des marchés émergents en monnaie locale et, bien qu’il y ait beaucoup d’élections dans ces régions en 2024, nous nous attendons à peu de changements et nous parions sur la continuité.
Pour conclure, quel est selon vous le problème économique majeur aujourd’hui ?
Christopher Dembik : Nous avons assisté à une énorme chute de la productivité ces dernières années, accélérée par le Covid. Et quand vous avez une baisse de la productivité, complétée par une inflation plus élevée qu’avant le Covid, et en même temps une croissance qui est un retour au niveau de 2019, c’est toujours un appauvrissement. Et l’appauvrissement signifie que le gâteau qui peut être distribué devient beaucoup plus petit. La « solution » consiste à augmenter les impôts, ce qui sera probablement inévitable. Fondamentalement, ce scénario d’appauvrissement et de déclin de la productivité est le plus grand problème économique que nous connaissons aujourd’hui. On n’en parle pas beaucoup parce que nous ne comprenons pas tous les facteurs à l’origine de ce déclin. L’année prochaine déjà, de nombreuses entreprises seront confrontées à cette réalité. D’une part, elles devront se refinancer à des taux d’intérêt plus élevés et, d’autre part, elles verront leur productivité et leur demande diminuer. Dans le même temps, leurs employés s’attendront à des augmentations de salaire supérieures à l’inflation. Ce dernier point deviendra difficile et la modération salariale deviendra la norme en raison de l’absence quasi-totale de productivité.




